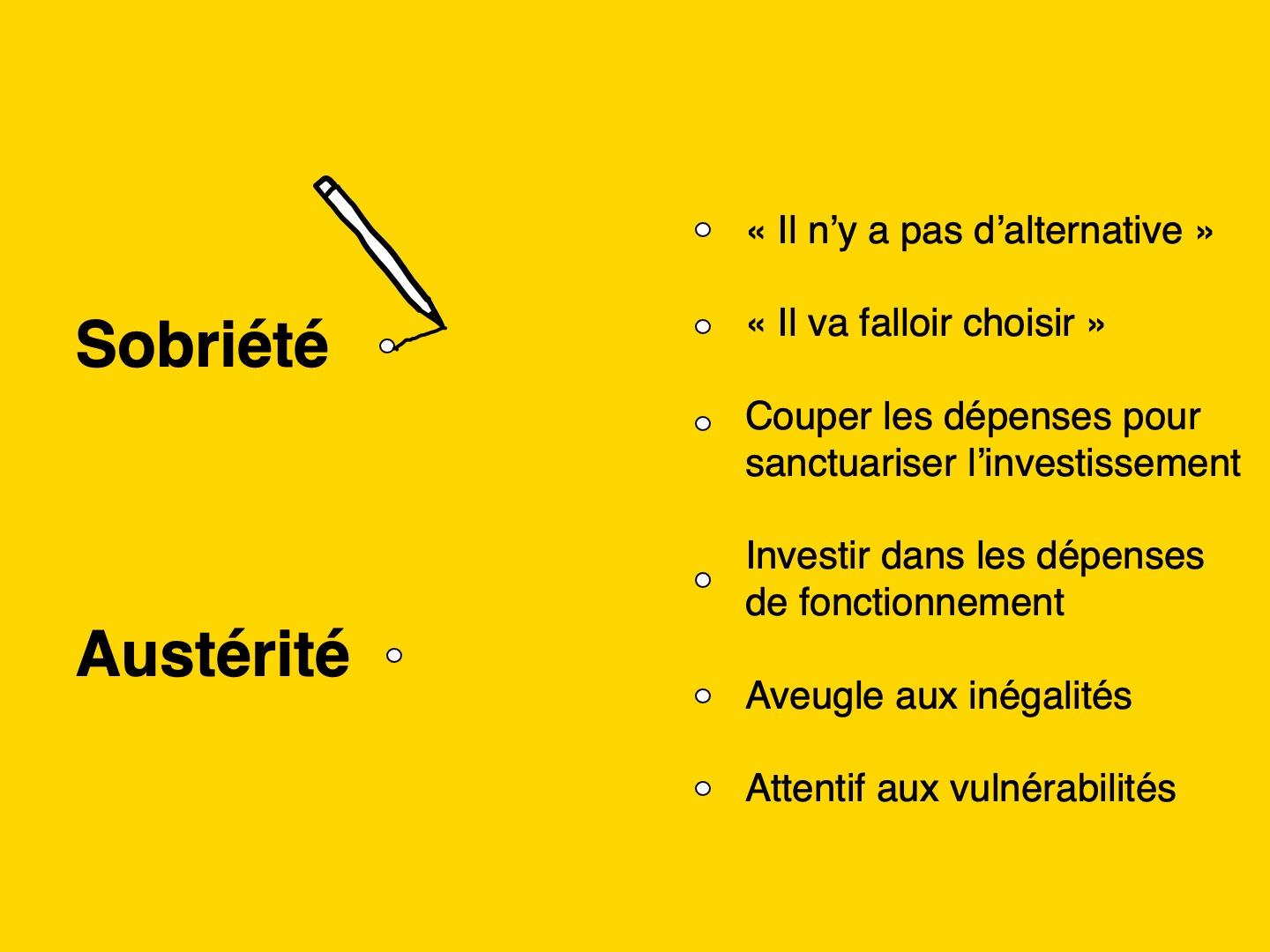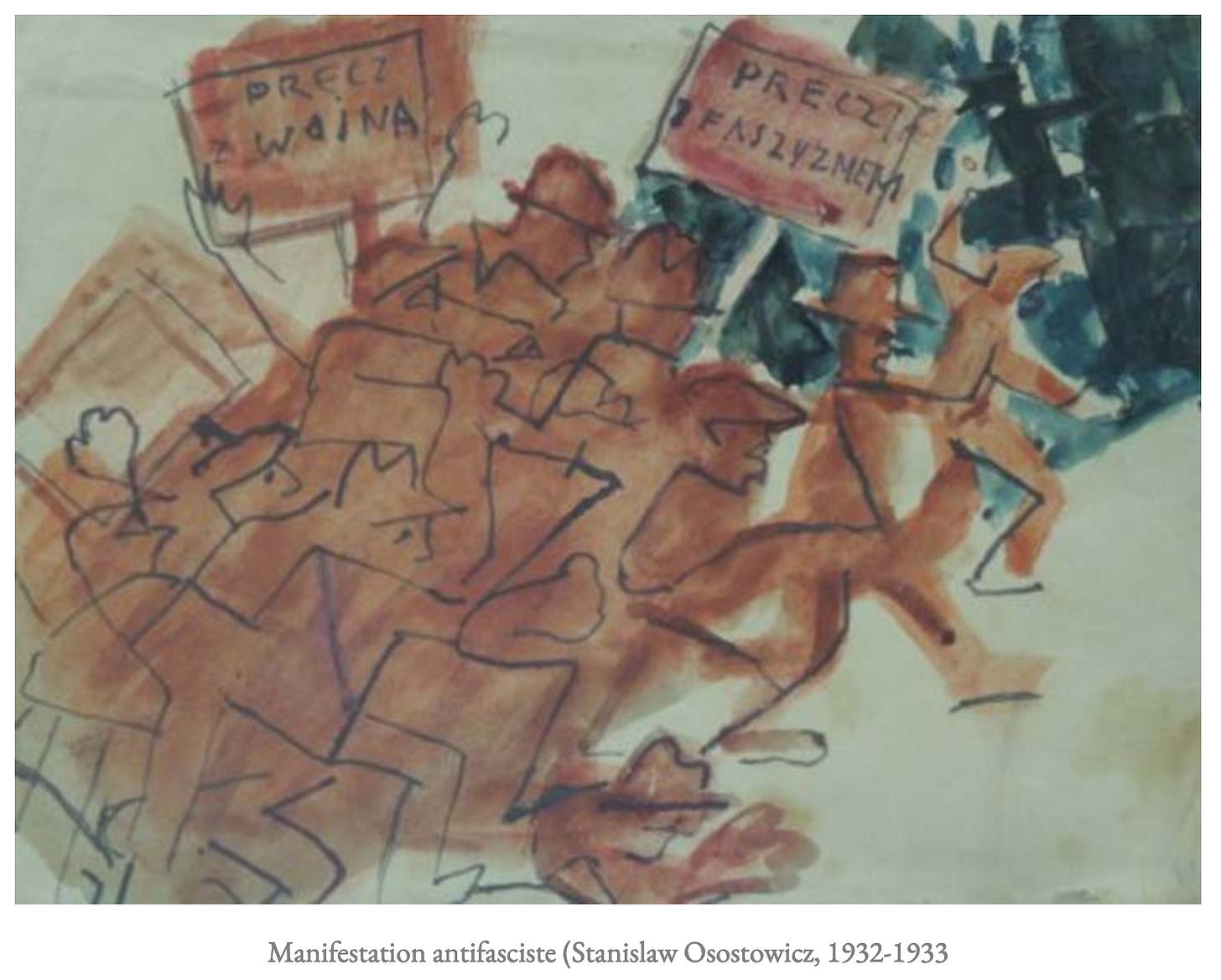Agonisme
Comme je n’ai pas d’idées d’intro originale toutes les semaines pour vous faire un édito, j’ai bien envie de systématiser une petite série en mode, qu’est-ce qui informe l’action publique, qui est gratos en accès libre mais qu’on oublie toujours de consulter ? Réponse : les rapports ! Chaque semaine je vous proposerai donc un rapport public dans un domaine différent.
On commence cette semaine avec le rapport sur Les soutiens publics aux éleveurs de bovins, par la Cour des Comptes
Livre #inspirant
Pelluchon C., Porcher J. (2022). Pour l'amour des bêtes. Mialet Barrault, 160 p. (Disputatio). ISBN 978-2-08-027100-6
À propos du travail, je voudrais insister sur le fait que, de mon point de vue, le rapport domestique aux animaux est historiquement fondé sur le travail, c’est pourquoi je propose de penser la domestication des animaux comme la dynamique de coévolution des espèces par le travail. Ce qui explique l’ampleur actuelle de nos liens de travail avec les animaux et le nombre incroyable d’activités dans lesquelles ils sont impliqués.
C’est parce que nos relations avec les animaux sont des relations de travail et qu’elles s’inscrivent dans des rapports de don que la mort des animaux y prend une place légitime du point de vue des éleveurs. Comme je l’ai écrit par ailleurs, en écho à Montaigne, la mort est le bout du travail, elle n’en est pas le but. Cette petite distinction sémantique change tout. L’euthanasie est le bout du travail d’un chien de compagnie, elle n’est pas le but. De même, l’abattoir est le bout du travail de la vache, elle n’est pas le but. Le but des éleveurs n’est pas de tuer leurs animaux, il est de vivre et de travailler avec eux.
Pourquoi ce livre ? Magnifique livre qui est un échange épistolaire sur la cause animale entre Jocelyne Porcher (sociologue - UMR Innovation) et Corine Pelluchon (philosophe - Université Gustave Eiffel). L’une est végane et l’autre est éleveuse paysanne.
J’ai beaucoup aimé ce petit livre, d’abord par sa forme qui réactive (c’est l’enjeu de cette collection éditoriale) la disputatio, cette forme de dialectique au fondement de la pensée universitaire. Chacun pose ses arguments et respecte l’autre c’est beau comme du Habermas (mais c’est souvent un fantasme-sciencepo) ! On voit très bien dans ce livre le contraste entre la position de l’intellectuelle praticienne et celle (C. Pelluchon) qui ne l’est pas.
Jocelyne Porcher, avec son magnifique parcours d’éleveuse et de chercheuse est de mon point de vue bien plus convaincante quand elle décrit l’enjeu du bon élevage par opposition bien sûr à l’agro-industrie, mais aussi par opposition au cache-sexe du bien-être animal, complice selon elle de la fuite en avant technologiste (viande artificielle). J’aime sa vision du travail ci-dessus. C’est une clé du débat. On y retrouve la belle distinction entre travail et emploi (au fondement des idées comme le revenu de base).
Non, on ne contractualise pas avec les animaux on crée des alliances et on est compagnons de vie et de mort avec eux, on produit quelque chose (aussi du compagnonnage pour les animaux de compagnie). A nous de choisir l’une des deux faces identifiées par Marx sur le travail : aliénation ou émancipation. Détruire et réifier dans des usines à viande ou se délier des animaux en les manipulant génétiquement, versus prendre soin, créer des aventures communes. Comprendre cette controverse est très utile je trouve.
Et si les politiques publiques arrêtaient de subventionner la production animale pour investir massivement sur l’élevage paysan ? On peut rêver, on DOIT rêver !
(merci Julie)
Le #carton_rouge à la différence entre investissement et fonctionnement dans les budgets publics
Saurez-vous faire la différence entre sobriété et austérité ? - Partie prenante
Dans un contexte de crise écologique, cette frontière théorique ne tient plus. D’une part, les investissements sont fortement consommateurs de ressources, pour leur construction comme leur exploitation : l’ouverture d’un centre aqualudique ou d’un contournement routier n’est pas vraiment gage de sobriété (un jour, Manon vous racontera son traumatisme sur tous les centres aqualudiques qui font office de projet de territoire pour nombre d’interco). D’autre part, les dépenses de fonctionnement peuvent aussi constituer un très bon investissement ! Un adjoint au patrimoine nous racontait par exemple sa bataille pour obtenir le recrutement d’un économe de flux : « les finances et RH refusent d’embaucher alors qu’au vu des économies d’énergie que ce poste permettrait de générer, c’est un placement à 15% par an ».
(…)
Concrètement, cela pourrait prendre la forme d’une programmation pluriannuelle de fonctionnement (PPF) en complément du rapport d’orientation budgétaire annuel.
En vis-à-vis de la PPI (programmation pluriannuelle des investissements, votée en début de mandature), ce PPF conduirait par ailleurs à mieux connecter dépenses d’investissement et dépenses de fonctionnement. On pourrait par exemple imaginer que les investissements abandonnés soient valoriser financièrement pour supporter les charges de fonctionnement rendues nécessaires par la sobriété : « vous préférez un centre aqualudique ou un service public local de la rénovation énergétique qui va aider les copro à passer à l’action ? »
Pourquoi ce carton rouge ? Vous aussi vous connaissez la rengaine ? “Ah si c’est en investissement pas de soucis, par contre en fonctionnement non on a pas de budget !”. C’est tellement ancré chez les fonctionnaires qu’on y prête même plus attention. Et s’il fallait suivre les auteurs de l’article ci-dessus et repenser la distinction ? Non pas l’abolir, mais la tordre, le remettre à sa place. Et s’il fallait les suivre sur ce changement technique qui serait aussi un changement de posture ? Qui connaît des collectivités qui se pose la question d’un PFF ?
Initiative #réjouissante
Les Entreprises publiques locales (Epl) agissent au cœur du développement urbain et rural en conciliant la satisfaction de l’intérêt général et les atouts de l’entreprise tout en s’appuyant sur les ressources locales. Leur credo ? Servir le public, sous l’impulsion et la maîtrise des collectivités locales.
Pourquoi cette initiative ? Une fois n’est pas coutume on parle ici d’un statut juridique plus que d’une initiative. Les EPL sont trop peu connues et très nombreuses (et pas seulement en aménagement) et représentent une voie intermédiaire entre public et privé, avec des options de gouvernance et de contrôle qui en font des outils souples, supports potentiels de communs territoriaux. Je vous recommande tout particulièrement les idées reçues en bas de cette page proposées sur le site de la fédération.
Ce n’est pas la panacée bien sûr, mais c’est une voie d’exploration qui peut impliquer - à l’image des SCIC - les collectivités à la fois financièrement et dans la gouvernance, aux côtés d’autres acteurs (cette fin de phrase est importante).
Le mot #stimulant
Radicaliser la démocratie : de la dimension agonistique de la démocratie
Radicaliser la démocratie : de la dimension agonistique de la démocratie
Pour Chantal Mouffe, l’antagonisme est une lutte entre ennemis, l’agonisme une lutte entre adversaires et pour elle, le but de la politique démocratique est de se réapproprier la démocratie et de réhabiliter le conflit de sorte que ceux qui s’opposent à d’autres en démocratie ne soient plus perçus comme un ennemi à détruire mais comme un adversaire, soit quelqu’un dont les idées peuvent être combattues mais qui disposent du droit de défendre celles-ci. Et dans cette théorie, la notion d’adversaire est la clé permettant d’envisager la spécificité de la politique démocratique pluraliste moderne : « dans un régime démocratique, les conflits et les affrontements, loin d’être des signes d’imperfection, indiquent que la démocratie est vivante et habitée par le pluralisme[15] » ; et dans ce cadre, « le but de la politique démocratique doit être de fournir un cadre où les conflits puissent prendre la forme d’une confrontation agonistique entre adversaires au lieu de se manifester par une lutte antagoniste entre ennemis[16] ». Cette « confrontation agonistique, loin de menacer la démocratie est la condition même de son existence.
Pourquoi ce mot ? Parce que j’aime beaucoup cette manière de réhabiliter une approche du conflit qui ne soit pas de la polémique ni du clash, ni même de la disputatio bien lisse comme j’en parle plus haut. Une approche qui ne nie pas les émotions et la controverse mais qui permette d’avancer et de se repérer dans les lignes de fractures.