Le Navire Mystique
Il se sera perdu le navire archaïque
Aux mers où baigneront mes rêves éperdus ;
Et ses immenses mâts se seront confondus
Dans les brouillards d’un ciel de bible et de cantiques.
Antonin Artaud, Poésies, 1913.
Vous avez découvert cette lettre par un autre canal ? Abonnez-vous pour la recevoir directement dans votre boîte de courriel :
Le mot #stimulant Chthulucène
« Vivre avec le trouble » du changement climatique : écoféminismes posthumains dans Le Roman de Jeanne de Lidia Yuknavitch (2017) et The Tiger Flu de Larissa Lai (2018)
Du grec chtonios « “ de, dans, ou bien sous la terre et les mers” », le Chthulucène invite à penser l’humanité non pas dans son exceptionnalisme mais plutôt dans sa connexion en réseau avec toutes les formes de vie et les forces géologiques (p. 53). En général, la cli-fi adopte le prisme de lecture de l’Anthropocène et/ou du Capitalocène en intégrant au récit le changement climatique anthropique, en se concentrant sur l’impact (inégal) des humain·es sur leur environnement et l’impact du climat sur les humain·es en retour (lui aussi inégal – on parle d’injustice climatique). Nous considérons que les romans à l’étude permettent aussi de penser le Chthulucène de Donna Haraway, et c’est là un autre aspect de ce qu’apporte l’écoféminisme à la cli-fi : un décentrement et une attention portée aux relations intriquées des humain·es au monde non-humain (y compris dans ses formes les moins visibles et les moins souvent intégrées à la fiction, comme les insectes ou les animaux souterrains) d’une part, et aux technologies d’autre part.
Pourquoi ce mot ? Parce qu’il est bizarre ce mot sa bizarrerie créée un trouble qui m’intéresse depuis longtemps. Il n’y a pas d’un côté le capital, la nature et les technologies, tout ça est infiniment plus complexe et imbriqué et c’est bien ça qu’il faut comprendre.
Article #inspirant
Futur ouvert : de la planification à la scénarisation - Métropolitiques
Avec l’objectif d’expérimenter des voies capables de recharger la planification – à bout de souffle car focalisée sur l’état spatial futur d’un territoire – par une approche ancrée dans la matière temporelle et partant de l’état présent des territoires, nous avons étudié différents modes de projection fictionnelle, et en particulier la fabrication des séries télévisées nord-américaines. Cette méthode scénaristique s’est imposée comme un outil malléable et efficace pour faire perdurer un récit sur plusieurs années tout en faisant face à un grand nombre d’incertitudes. En associant à la permanence de la « bible » – document qui stabilise les principales caractéristiques constantes du récit (figure 2) – une suite de saisons autonomes, thématisées et évolutives, la scénarisation montre qu’il est possible de maintenir une visée lointaine tout en accordant une importance et une problématique propres à chaque temps de projet, à commencer par le présent.
Par analogie avec cette méthode, « scénariser » la transformation de la ville revient à reconnaître que l’état d’un territoire ne peut être figé, achevé ou idéal, mais se trouve au contraire dans un mouvement perpétuel tendant vers le déséquilibre. Il est mû par la recherche d’un devenir, d’une autre forme. Le projet n’est alors plus l’étape transitoire de la réalisation d’un plan mais, comme les saisons et les épisodes des séries, un moment de la vie de ce territoire.
Pourquoi cet article ? Attention article important ! Et si la clé c’était le temps avec pour modèle la temporisation des séries ? Arrêtons de multiplier les plans et passons en mode série, c’est-à-dire en saisons ! Quand on s’y penche c’est vraiment intéressant parce que c’est assez proche de ce qui se fait déjà pour être adopté facilement en commençant par le vocabulaire. Nous on parle de plus de plus de saisons par exemple pour les expérimentations itératives, et vous ?
Merci Léo ! (2e dédicace, encore une et tu gagnes un cadeau, le concours est ouvert à tous !)
Initiative #réjouissante
Quimper donne une seconde vie aux pierres tombales
Le granit poli est arrivé, plus facile d’entretien. Des monuments étaient donc jetés, « c’était du gaspillage, poursuit-il. Et les usagers trouvaient cela dommage ».
(…)
A l’époque, seuls les représentants des marbriers tiquent. Mais Daniel Lescoat leur rappelle la loi : la procédure de reprise de concessions, définie aux articles R.2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales, autorise la revente des monuments par la commune(1).
Pourquoi cet article ? Parce que j’aime bien ce genre de démarche de bon sens et qu’on parle trop peu du service public funéraire, au cœur de nombreux enjeux. Intéressant aussi de voir qu’il faut justifier ne pas faire concurrence au marché… la charge de la preuve est toujours du côté des services publics et c’est un problème. Et j’ai d’ailleurs toujours rêvé de faire travailler des designers sur une question de conception funéraire!
Le #carton_rouge à l’opacité des contrôles d’identité
Police : faut-il en finir avec le contrôle d'identité ?
L'absence de remontée des données et d'évaluation est pointée depuis plusieurs années par les Défenseurs des droits successifs. "En l’absence de dispositif de traçabilité des contrôles, aucune donnée officielle d’activité ne permet d’évaluer ces pratiques, et notamment leur répartition au sein de la population, ce que déplore le Défenseur des droits depuis 2012" est-il ainsi écrit dans un rapport de 2017 sur les relations police-population, portant sur les contrôles d'identité. "Il y a des contrôles d'identité qui sont discriminatoires" et "ne rien faire en ce moment" sur ce problème, "c'est ne pas s'attaquer au problème de la relation police-population", qui "est au centre du Beauvau de la sécurité" déclare de son côté la nouvelle Défenseure des droits, Claire Hédon. Elle a à nouveau appelé, mardi 16 février, à ce que soient expérimentés certains dispositifs: récépissé, quantification, enregistrement du nombre de contrôles faits, ou caméras.
Pourquoi ce carton rouge ? Parce que l’enjeu est bien de briser l’opacité entretenue autour de cette pratique comme l’ont fait pas mal de pays européens qui ont tous fait évoluer les contrôles d’identités. Comment comprendre et agir sans thermomètre ? Comment ne pas voir qu’il y un problème de discrimination?



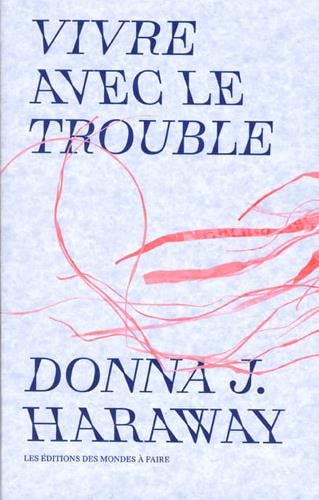



J’avais travaillé en 2018 lorsque j’étais à la mairie d’Armentières, avec ma collègue directrice du CCAS sur ce sujet qu’est la reprise des pierres tombales des monuments arrivés en fin de concession… il s’agissait ainsi de permettre aux familles sans moyens financiers, de pouvoir retrouver une certaine dignité dans l’accompagnement de leurs proches pour l’ultime voyage… merci d’avoir partagé cette initiative de la Ville de Quimper.