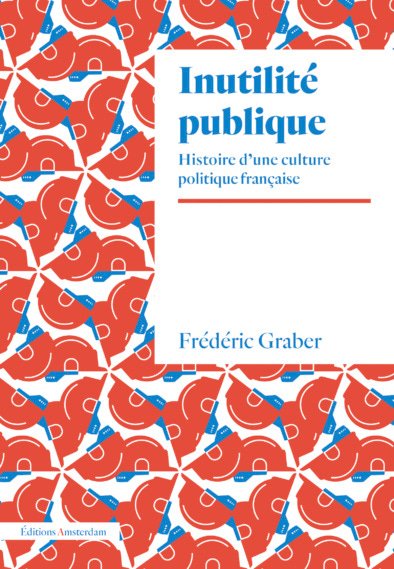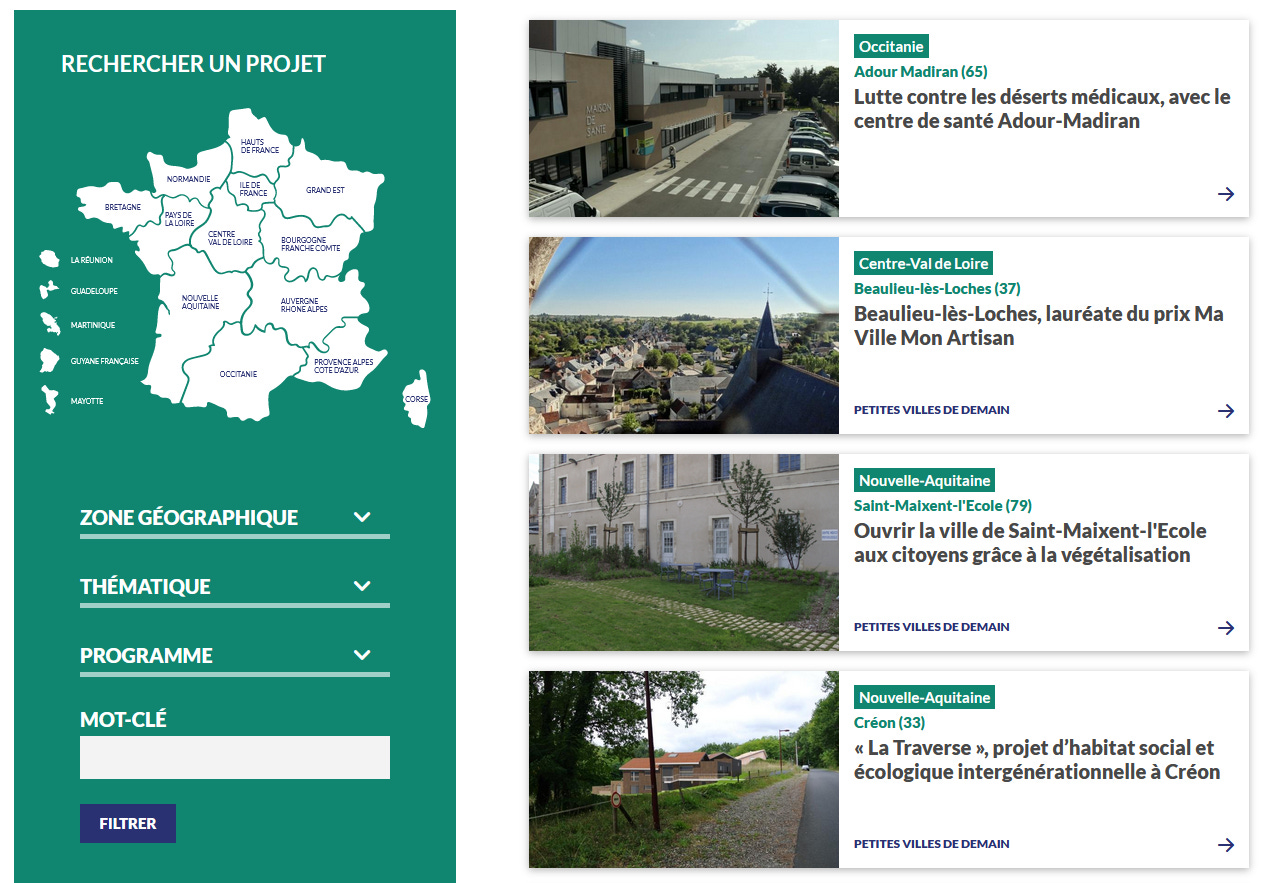Découvrabilité
J’ai proposé récemment une formation sur les “expériences d’intérêt général” à un groupe de DGS (directeurs généraux des services) de communes de moins de 40 000 habitants, je vous assure que ce n’est pas un public facile, parce que le job ne l’est pas du tout. Mais c’était quand même rudement satisfaisant de sentir quelques lignes bouger dans un océan de difficultés !
Le mot #stimulant Découvrabilité
La définition est simple et comporte deux volets. La découvrabilité, c’est :
1 - la capacité d’un contenu culturel de se laisser découvrir aisément par le consommateur qui le recherche : grâce à quelques mots clés et une pratique réduite du nombre de clics, l’internaute est capable de trouver l’information qu’il cherche.
2 - la capacité d’un contenu culturel à se faire proposer au consommateur qui n’en connaissait pas l’existence. Cela fait référence notamment au système de recommandation : avez-vous remarqué que vos habitudes de navigation – vos clics, vos likes, vos mot-clics (#) — sont soigneusement enregistrées par les géants du Web pour vous proposer des offres similaires ? Si vous êtes passionné par un sujet quelconque, les puissants navigateurs de ce monde seront en mesure de vous en proposer les tendances ! Cela est notamment dû à ce qu’on appelle l’intelligence artificielle qui s’adapte aux préférences des utilisateurs estimées par les algorithmes.
Pourquoi ce mot ? J’adore ce mot parce qu'il incarne pleinement la redirection des métiers des bibliothèques qui passent de la gestion de stock et d'événements à la conception de dispositif qui rendent les savoirs découvrables. Avec mon ami Lionel Dujol, il y a quelques années on a écrit un livre sur le sujet qui est en accès libre et gratuit. J’ai pas mal prêché, parfois dans le désert, sur ces questions. Ravi de voir que tout ce qu’on avait pressenti à l’époque n’a fait que s’amplifier.
Article #inspirant
Les initiatives citoyennes de transition: signification et perspectives politiques.
Une autre forme de collaboration entre stratégie symbiotique et stratégie interstitielle consisterait à appliquer à ces niches que sont les initiatives de transition des opérations de « Transition Management » du genre de celles qui s’appliquent aux innovations technologiques. Le « transition management » qui constitue le volet pratique et politique de l’approche multi-acteurs multi-niveaux consiste en définitive à orienter et canaliser des processus en cours de transformation interstitielle. Essentiellement, il s’agit dans un premier temps d’encourager l’expérimentation, l’apprentissage et la prospective autour d’innovations potentiellement viables. Ensuite, il sera davantage question de juguler les effets secondaires indésirables de la mise en œuvre à grande échelle de ces innovations. Pratiquement, le « transition management » est conçu comme un processus cyclique et itératif d’apprentissage collectif, mobilisant sous l’impulsion et la guidance des pouvoirs publics le monde scientifique, les acteurs économiques et la société civile et structuré autour de 4 instruments, à savoir:
Des arènes de la transition (une instance de délibération et de construction d’une vision);
Une vision prospective : des objectifs de durabilité à long terme traduits en visions du futur et en chemins de transition ;
Des projets innovants considérés comme des expérimentations (en l’occurrence ici, les initiatives de transition);
Un monitoring et une évaluation permanents de l’ensemble
Pourquoi cet article ? Parce qu’il fait très bien le lien avec l’article que je soulignais la semaine dernière à propos des stratégies de changement. Ici l’auteur réinvente le PCAET (vision stratégique) et les expérimentations menées par certaines collectivités ! Comme quoi une action publique qui fonctionne est par nature une force de changement, il faut s’en convaincre à nouveau en ces temps de morosité!
merci Thomas!
Initiative #réjouissante
A Dunkerque, le quartier des Glacis a son concierge !
Khalil Bachiri a été nommé concierge du quartier de Glacis par le maire de Dunkerque Patrice Vergriete. Il a pour objectif, de résoudre rapidement les nombreux problèmes du quotidien, vécus par les 4000 habitants. Le concierge de quartier se fera le trait d’union entre la population et les services techniques.
Pourquoi cette initiative ? Parce que c'est du concret et que j'ai eu l'occasion au détour d'une formation CNFPT à Dunkerque de rencontrer Khalil. Il incarne tout ce qu'il faut faire aujourd'hui dans l'action publique, c'est-à-dire prendre le lien de proximité au sérieux. Le métier de Khalil c'est bien de prendre soin du quartier. Mais il n'est ni un un éducateur ni un agent de voirie ni un grand frère, ni un animateur de participation citoyenne. Khalil il est un peu tout ça et c'est un agent public de la ville, très bien encadré et soutenu par la mairie de quartier qui s'appuie sur les liens qu'il entretien pour développer la participation citoyenne de confiance ou percevoir les usages de terrain. Khalil il peut compter les passages à un carrefour pour un projet de voirie, signaliser un problème nid de poule ou une poubelle cassée ou encore co-organiser la fête des voisins ! Son job s'arrête au pied des immeubles qui ont parfois leurs propres gardiens. Ce n’est pas le gardien d’un quartier bourgeois mais il exerce en quartier de veille politique de la ville. L'expérimentation trop peu connue date de 2018 et la mairie a commencé à recruter d'autres concierges de quartier sur le même profil. Hé les collègues de collectivités, partagez, ça marche et on a pas besoin de repartir de zéro pour ce qui marche!
Le #carton_rouge
Frédéric Graber, Inutilité publique. Histoire d’une culture politique française
La dimension démocratique reste ainsi faible, car les débats n’ont toujours pas d’incidence sur les résultats de l’enquête. Il s’agit davantage d’un discours rhétorique que d’une réalité. Aussi, de nombreuses critiques sont faites sur l’irréversibilité de la conclusion des enquêtes publiques. Par la suite, ces critiques servent alors à justifier le vote d’une série de lois, entre 2009 et 2019, qui limitent progressivement les délais et les champs d’application des enquêtes publiques, pour aboutir finalement, en mars 2018, à la suppression à titre expérimental des enquêtes publiques, remplacées par des consultations électroniques. Puis le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 permet aux préfets de s’affranchir des enquêtes publiques et de l’évaluation environnementale. Dès lors, la façade délibérative de l’enquête publique n’est plus, malgré les enjeux démocratiques qui y étaient pourtant liés : l’importance du contradictoire et de la transparence du débat.
Pourquoi ce carton rouge ? Voici une démonstration précise de ce avec quoi il fait en finir dans l’action publique ! Les enquêtes publiques sont une mauvaise réponse à de vrais enjeux. A nous de réinventer des formes de démocratie délibératives autour des projets urbains. Pour le coup la conception (design des politiques publiques) pêche par refus du conflit et de la contradiction. On invente quoi d’autre pour débattre sans manipuler ?
La source #recommandée
L’ANCT vous présente des projets et réalisations de collectivités et d’acteurs locaux qu’elle accompagne ou qu’elle a repérés pour vous. Un partage d’expérience à découvrir à travers des fiches de cas pratiques, des témoignages et des reportages.
Pourquoi cette source ? On prend trop peu le temps de documenter les projets et c’est à mon sens un des rôles des institutions “supra” comme on dit dans les ministères… Voilà une bonne source quand on cherche de l’inspiration ou des projets équivalents pour convaincre, à garder dans un coin pour y retourner de temps en temps !