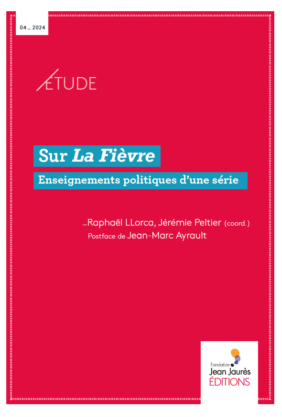Nexus Santé-Environnement-Agriculture-Alimentation
L’expression #stimulante
La notion de Nexus est récemment apparue dans un certain nombre d’instances internationales dans le prolongement des publications du Millenium mettant en avant 17 objectifs pour un développement durable au niveau mondial (Dora et al., 2014). Utilisée à l’occasion, par exemple, des réflexions sur les relations entre énergie-eau-alimentation ou entre climat-services écosystémiques-santé, la notion de Nexus a été proposée pour tenir compte du fait que parmi les 17 objectifs mis en avant, certains sont étroitement liés, de façon positive ou négative, et doivent donc être associés dans la construction des priorités de recherche et la définition ou l’évaluation des politiques publiques.
Les réflexions sur le Nexus Santé-Environnement-Agriculture-Alimentation s’inscrivent dans cette perspective en incitant à (i) tenir ensemble dans l’analyse ces différentes composantes de façon prendre en compte la complexité des interactions entre les dimensions économiques, sociales, environnementales et sanitaires des activités qui se déroulent au sein du système alimentaire, (ii) exploiter les synergies possibles entre objectifs ou domaines d’action généralement considérés séparément.
Pourquoi cette expression ? J’aime beaucoup ce mot de nexus parce qu’il appelle à des hybridations systémiques (pléonasme) qui sont justes indispensables aujourd’hui. C’est intéressant d’ailleurs de voir que la notion vient des instances internationales et en particulier dans les liens entre humanitaire et développement, pour tenter d’éviter les effets pervers des aides qui inhibent le développement local des territoires.
Voir la notion de nexus essaimer à ce point est un signe des temps et sur les questions de transitions je pense vraiment que l’enjeu de la santé est finalement le meilleur levier pour convaincre. Mobiliser sur les transitions n’est pas seulement affaire de carbone ou d’écogestes, mais de la santé de nos proches. Quoi de plus fort pour embarquer les gens ?
L’article #inspirant
(…) L’une des questions que pose la série, à mon sens, est la suivante : « Peut-on être lucide et heureux ? ». Évidemment, la réponse est oui, tout dépend de notre capacité à trouver le « juste milieu », que Romain Gary définissait ainsi : « Le juste milieu. Quelque part entre s’en foutre et en crever. Entre s’enfermer à double tour et laisser entrer le monde entier. Ne pas se durcir, mais ne pas se laisser détruire non plus. Très difficile. » C’est le dilemme permanent que doit affronter Sam Berger (se retirer ou y retourner au risque de se blesser attendre que la fièvre passe ou au contraire l’affronter ; décider de se foutre des affaires du monde ou continuer à s’y intéresser) et qui la rend universelle tant ce dilemme touche aujourd’hui à la fois les gens loin du jeu et les acteurs mêmes de ce qu’on appelle le « débat public », incapables de cesser de penser : « Il y a des jours où on n’a même plus le goût pourvoir le goût des choses. On voudrait se dissoudre, plus penser ; c’est le drame de l’homme, ça ! Pas pouvoir s’arrêter de penser » (Bernard Blier, Les Bons Vivants).
Pour conclure, si la série La Fièvre est évidemment un puissant miroir de l’actualité, des réseaux sociaux,des polémiques à répétition et de la politique, elle n’en demeure pas moins une description très fine de l’état mental des individus qui composent à l’heure actuelle notre société. En cela, elle offre quelques outils qui peuvent en effet sembler obsolètes ou vieux jeu de prime abord, mais qui pourtant sont le ciment de notre bonne santé et de l’émancipation des individus : l’action collective (plutôt que l’action ou l’activisme solitaire), le temps long (plutôt que la cause court-termiste), les sociabilités (plutôt que l’isolement) – en sus de la famille et des petits plaisirs volés sur le rythme imposé de nos vies.
Pourquoi cet article ? Je vous recommande chaudement cette série ! Le moins que l’on puisse dire est qu’elle crée le débat et qu’elle est riche au point que la Fondation Jean Jaurès (proche du PS) lui a consacré un ensemble d’article dont vous avez ci-dessus un extrait que je trouve magnifique, la citation de Romain Gary est très bien trouvée et surtout incarnée par les hésitations de Sam Berger, personnage fascinant. Allez je ne divulgâche rien, ne manquez pas cette série !
Le #carton_rouge au mythe de l’impact négatif de la piétonnisation sur le commerce local
« No parking, no business » en centre-ville : un mythe à déconstruire - The conversation
Enfin, et c’est sans doute le constat le plus important pour comprendre la teneur des débats, les études révèlent que les commerçants surestiment largement la part de clients qui viennent en voiture.
À cet égard, l’exemple le plus frappant est celui de Nancy, où les commerçants interrogés croyaient que 77 % de leurs clients venaient en voiture : c’est en réalité le cas de… 35 % d’entre eux. Ils imaginaient également que les piétons ne représentaient que 11 % de leur clientèle, contre 39 % dans les faits, et que 1 % s’y rendaient à vélo, alors que les cyclistes composent 13 % de leurs acheteurs Cette surestimation a pu être observée dans beaucoup d’autres villes. Dans ce contexte, il est peu surprenant que les commerçants craignent plus que tout les projets de réduction de la place de la voiture.
Les raisons de ce biais sont diverses. En France, les commerçants font partie de la catégorie socioprofessionnelle qui utilise le moins les mobilités alternatives. Eux-mêmes se déplaçant beaucoup en voiture, ils semblent calquer leur cas personnel sur l’ensemble de leur clientèle.
Autre explication à ce biais : les automobilistes sont globalement assez « râleurs » et expriment fréquemment leur mécontentement auprès des commerçants vis-à-vis des conditions de circulation ou de stationnement. Nous avons tous déjà entendu un client annoncer « on ne peut plus se garer dans le quartier » à peine la porte du commerce poussée. Les commerçants l’entendent cinq fois par jour.
A contrario, les piétons formulent bien moins souvent ce genre d’agacement, alors même que les cheminements sur les trottoirs laissent bien souvent à désirer (présence d’obstacles, de poubelles… voire d’automobilistes stationnés sur le trottoir !).
Pourquoi ce carton-rouge ? J’aime bien cette déconstruction qui est très utile et montre bien que le changement n’a rien de simple quand il affronte des biais si difficiles à remettre en cause. Voilà qui montre la piétonnisation est bien plus qu’un enjeu technique.
Initiative #réjouissante
Talent Exchange pour les collaborateurs - talent exchange
Pour qui ? Vous êtes un collaborateur (statutaire ou contractuel à durée indéterminée) du secteur public belge et vous êtes en fonction au sein d’une des organisations membres du réseau Talent Exchange.
Pourquoi ? Vous avez envie de booster votre carrière ? D’acquérir de nouvelles compétences ? De gagner de l’expérience ?
Comment ? Talent Exchange vous offre la possibilité de travailler de manière temporaire au sein d’autres organisations membres du réseau, dans un objectif de développement et de partage de connaissances.
Pourquoi cette initiative ? Parce que j’ai entendu un nombre incalculable de fois l’idée d’organiser des échanges de poste, ou encore des “vis ma vie” dans les organisations ou j’ai travaillé. Les belges l’ont fait, bravo à eux !