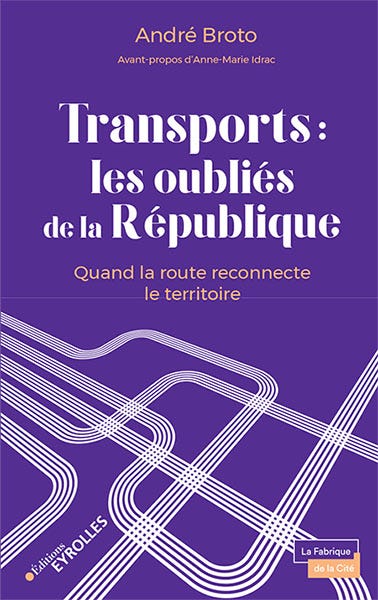[Parcours de lecture] Transports : les oubliés de la République
Voici un hors série! Je vous propose un parcours de lecture sous forme d'une sélection de passages d'un livre, je suis l'auteur des titres ci-dessous mais tous les passages sont des citations.
Pourquoi ce livre ? J’ai beaucoup aimé ce livre d’André Broto, ingénieur et ancien directeur de la stratégie de Vinci Autoroutes… oui bon il défend la route forcément… mais je trouve que ses arguments sont pertinents et sa posture aide certains acteurs publics locaux obsédés par les transports en commun à changer un peu de focale. Non la voiture n’est pas l’ennemi absolu et oui les politiques publiques de mobilité axées sur les transports collectifs ne permettent pas toujours les reports modaux espérés (dixit la Cour des comptes).
Moi qui ne suis pas un spécialiste des transports je trouve que le livre est une très bonne pierre à l’édifice des défis climatiques que doivent affronter nos politiques de mobilité.
Conseil : ne manquez surtout pas les vidéos mentionnées ci-dessous, les exemples sont vraiment très inspirants !
Les déplacements longs du quotidien sont les oubliés des politiques publiques
Les déplacements longs du quotidien, de plus de 10 kilomètres, représentent près de 50 % des voyageurs-kilomètres effectués en voiture. Ces 50 % pèsent quant à eux environ 57 % des émissions de gaz à effet de serre liées à l’usage de la voiture ! Autrement dit, quand un grand banlieusard arrive à Paris, Toulouse ou Lyon, il a émis l’essentiel des pollutions. Il n’aurait jamais dû utiliser sa voiture pour un trajet aussi long, aussi polluant, dans une zone aussi dense.
Résumons la situation française : les déplacements longs du quotidien sont responsables de plus de la moitié des émissions de CO2 dues au transport des voyageurs (estimation de 39 millions de tonnes pour un total de 67), et ils posent de forts problèmes d’équité, particulièrement dans les périphéries des grandes métropoles disposant de systèmes de transport public performants. Ils représentent en outre la majeure partie des volumes de circulation, donc des enjeux de qualité de l’air et de la place de la voiture dans les grandes villes-centres.
S'inspirer du magnifique exemple de Madrid : les autocars périurbains en voies réservées et des pôles intermodaux exemplaires
Le modèle de la CAM de Madrid confirme qu’il est possible d’offrir une alternative à la voiture individuelle pour les déplacements du quotidien longs sur la base de tarifs attractifs pour les automobilistes, et suffisamment élevés pour couvrir la majeure partie des coûts de fonctionnement du service. En d’autres termes, dès lors que le service est de qualité, les autosolistes sont prêts à abandonner leur voiture, à prendre en charge le coût du bus et à enchaîner plusieurs modes de transport.
Ces pôles sont conçus pour optimiser la fluidité de l’enchaînement modal : les différentes gares (métro, bus interurbains, bus urbains) sont superposées et reliées par des ascenseurs. Les autobus passent de l’autoroute au pôle via un accès souterrain réservé aux bus de quelques centaines de mètres.
Le lecteur pourra vérifier la pertinence du modèle madrilène en visionnant un film d’une dizaine de minutes sur le lien suivant :
Si nous avions analysé le segment de marché des déplacements longs du quotidien à Madrid ou dans d’autres pays non européens, on aurait vu apparaître un mode – l’autocar express sur voie rapide – nettement plus efficace que la voiture, et exigeant beaucoup moins de subventions que le TER. Mais il ne faut pas confondre ce mode avec le bus : l’autocar sur voie rapide est au bus ce que le TGV est au TER, il vise des classes de distance plus longues, avec très peu d’arrêts, et à grande vitesse.
Remettre l'autocar à l'égal du train pour organiser les transports
On peut résumer ce modèle par la triade « rabattement, transit, diffusion ».Ce que nous observons dans les exemples cités, c’est qu’il est possible et souhaitable de généraliser ce modèle et de l’appliquer aux modes routiers pour la partie « transit ». L’intérêt majeur de l’option routière est de permettre d’appliquer le modèle ferroviaire à des situations où la demande est dix fois plus faible, car l’autocar est un véhicule dix fois plus petit, dix fois moins coûteux à exploiter que le train.
Cette option permet en outre de desservir plus finement les territoires en allant au plus près des communes rurales, et enfin d’aménager rapidement, à des coûts beaucoup plus faibles, des parcs relais pour accueillir les voitures, vélos ou bus de rabattement (car les gares en milieu urbain se prêtent mal à des extensions d’offre de stationnement à bas coût). Il permet enfin d’aller chercher les automobilistes là où ils sont, sur l’autoroute. Nous devons donc nous nous demander, d’une part, quelles sont les raisons de cette amnésie collective sur les vertus de l’autocar, égal du train (et donc du modèle madrilène pourtant proche de nous et de nos cultures), d’autre part, quels sont les avantages et inconvénients d’une intermodalité organisée autour de l’autocar pour la fonction transit.
C’est la bonne question : nous cherchons en France à répondre aux besoins avec deux types de véhicules seulement, des véhicules pouvant transporter des centaines de passagers (le train) et des véhicules pouvant transporter quelques passagers (la voiture). En niant la possibilité d’utiliser des véhicules pouvant en transporter quelques dizaines, nous nous condamnons à une double peine : des coûts élevés pour des trains vides, un échec du report modal et donc de la lutte contre le changement climatique.
Échec du report modal malgré les investissements massifs alternatifs à la route (en raison de l’augmentation de la demande de déplacement)
Le constat est donc paradoxal : la trentaine de milliards additionnels investis dans les modes alternatifs à la route n’a pas permis d’atteindre l’objectif de report modal sur le plan national, alors même que ces investissements sont plébiscités par les usagers. Ce paradoxe n’est qu’apparent. D’une part, les améliorations constatées ne portent que sur une part faible de la demande de transport (rappelons que la voiture assure 81 % des besoins) et, d’autre part, le report modal de la voiture vers ces nouveaux services est beaucoup plus faible que ce qui était espéré. Si les LGV ont absorbé 43 400 millions de nouveaux usagers (58 600 moins 15 200), dans le même temps, les trains interurbains en perdaient 27 000 millions ! En réalité, le total du trafic TGV + trains interurbains est passé de 47 800 millions à 64 100 millions, soit 34 % d’augmentation, chiffre à comparer à l’augmentation de la demande de transport, soit 28 % sur la même période : le différentiel n’est plus que de 5 ou 6 %.
Ce satané effet rebond…
On assiste donc à une augmentation des émissions de CO2 des transports de 9 % entre 1990 et 2019, et ce malgré une amélioration continue de l’efficacité énergétique des motorisations. En effet, les consommations unitaires des véhicules immatriculés en France ont baissé sur la même période de 23 % pour les véhicules particuliers, 10 % pour les véhicules utilitaires légers et 8 % pour les poids lourds. Mais sur la même période, les kilomètres parcourus ont augmenté de 44 %, dont 40 % pour les véhicules particuliers, et 30 % pour les poids lourds. Nous voyons là les conséquences de « l’effet rebond » : les ménages utilisent le progrès technique et la réduction des coûts qui en résultent pour voyager plus souvent ou plus loin, ou pour acheter des véhicules plus grands et plus lourds.
Sortir du tropisme ferroviaire de la France pour les transports régionaux !
En outre, le tropisme ferroviaire de la France nous a conduits à pousser ce modèle, par ailleurs très vertueux sur la longue distance avec le TGV et sur les courtes distances avec le métro, au-delà de son domaine de pertinence. Il en résulte des coûts pour la collectivité, par voyageur transporté, qui sont parfois très loin de l’optimum. Pour l’exemple emblématique des TER, la Cour des comptes pointe des marges de réduction des coûts importantes et un bilan écologique peu satisfaisant : « Si l’on considère les taux moyens (d’occupation) constatés sur les liaisons régionales, les émissions de CO2 par voyageur-kilomètre sont plus faibles (de 30 % environ) pour les autocars que pour les trains. Dans les conditions moyennes d’utilisation, c’est-à-dire avec deux passagers par véhicule, les voitures particulières émettent deux fois plus de CO2 que les trains, mais avec quatre passagers par véhicules elles en émettent autant que les trains avec leur taux d’occupation moyen. » La Cour conclut que pour la plupart des lignes non électrifiées, « le transfert sur route se traduit systématiquement par une baisse des émissions de gaz à effet de serre », et que le coût pour les finances publiques des TER est équivalent au « coût d’usage moyen de la voiture individuelle. » Elle encourage un report sur la route, en recourant à des bus cadencés ou même à des taxis !
On comprend donc la complexité des déplacements longs du quotidien, la nécessité de penser l’ensemble de la chaîne, mais aussi les limites du report modal vers les modes lourds. La région Occitanie a ainsi beaucoup investi dans les TER, avec une fréquentation en augmentation de 60 % en quinze ans (56 000 voyages par jour tous motifs confondus), mais ce n’est pas à l’échelle des 630 000 salariés occitans qui effectuent plus de 10 kilomètres chaque matin pour le seul motif domicile-travail, pour lequel le TER n’assure qu’environ 30 000 voyages par jour, soit 5 % du total. Quels que soient les efforts que nous ferons au titre des TER, ils resteront marginaux par rapport aux enjeux climatiques.
Construire des réseaux certes mais surtout retravailler les interfaces !
Plus généralement, la question de fond est de savoir comment transporter plus et mieux avec les grands réseaux existants (ferroviaires, transports en commun urbains, et voies rapides) en dépassant les questions d’échelle et de périmètres des AOT. Comme le note Cyprien Richer, « les AOTU semblent donc davantage préoccupées par la mise en place de nouvelles infrastructures (routières ou ferrées en site propre) que par la valorisation des interfaces entre les réseaux existants ou projetés ».
Penser une intermodalités sur le modèle de la logistique marchande
Ces vertus de l’intermodalité, nous ne les découvrons pas : elles sont les principaux ressorts de l’extraordinaire efficacité du transport des marchandises. La logistique repose précisément sur ces notions de rabattement et de pôles de regroupement (des « plateformes logistiques » aux « points relais »), suivies de zones de diffusion fine (le dernier kilomètre). Ne faudrait-il pas en ce sens créer sur l’ensemble du territoire une armature de PER qui équiperaient non seulement les quelque 1 000 points d’accès aux réseaux d’autoroutes et de voies rapides, mais aussi les territoires éloignés de l’autoroute ? Cela aurait l’autre avantage de faire baisser considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, conformément aux prescriptions de la stratégie nationale bas carbone.
Vers une stratégie centripète, progressive et systématique
La stratégie est centripète, progressive et systématique : centripète, parce qu’elle cible en priorité les flux les plus lointains ; progressive, car sur la première période (cinq ans), le service ne serait proposé que les jours ouvrables et sur les heures de pointe (soit 6 à 7 heures par jour ouvrable), et il serait progressivement étendu aux autres jours et plages horaires en fonction de la demande observée ; enfin systématique, parce que les lignes seraient dès le début mises en place sur les cent plus grandes villes et sur tous les grands axes radiaux (autoroutes et deux fois deux voies) qui convergent vers ces villes.
Dès aujourd’hui : l'exemple de Voiron-Grenoble
Grenoble mise sur l'intermodalité et l'attractivité des transports collectifs
Sur le tronçon Voiron-Grenoble, la ligne Voiron Grenoble suit le tracé du TER (en pointillé sur la carte suivante). Cette ligne a vu son trafic multiplié par cinq en dix ans : son trafic actuel est de 5 000 voyageurs par jour. Une voie réservée a été réalisée sur une dizaine de kilomètres sur l’A48 et cette voie est utilisée par 14 lignes de transport en commun.
Parce qu’un jour sans veille est un jour sans lendemain!